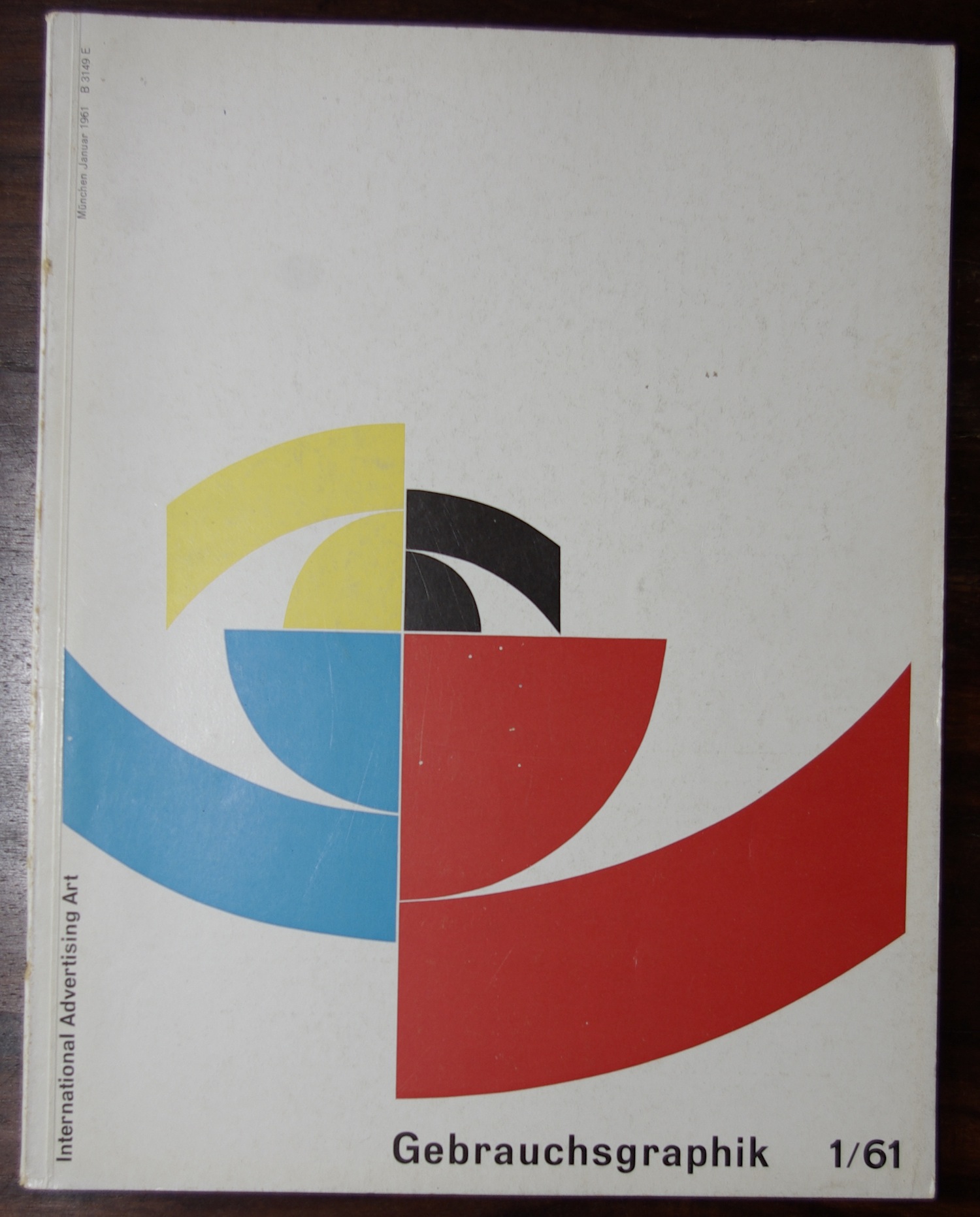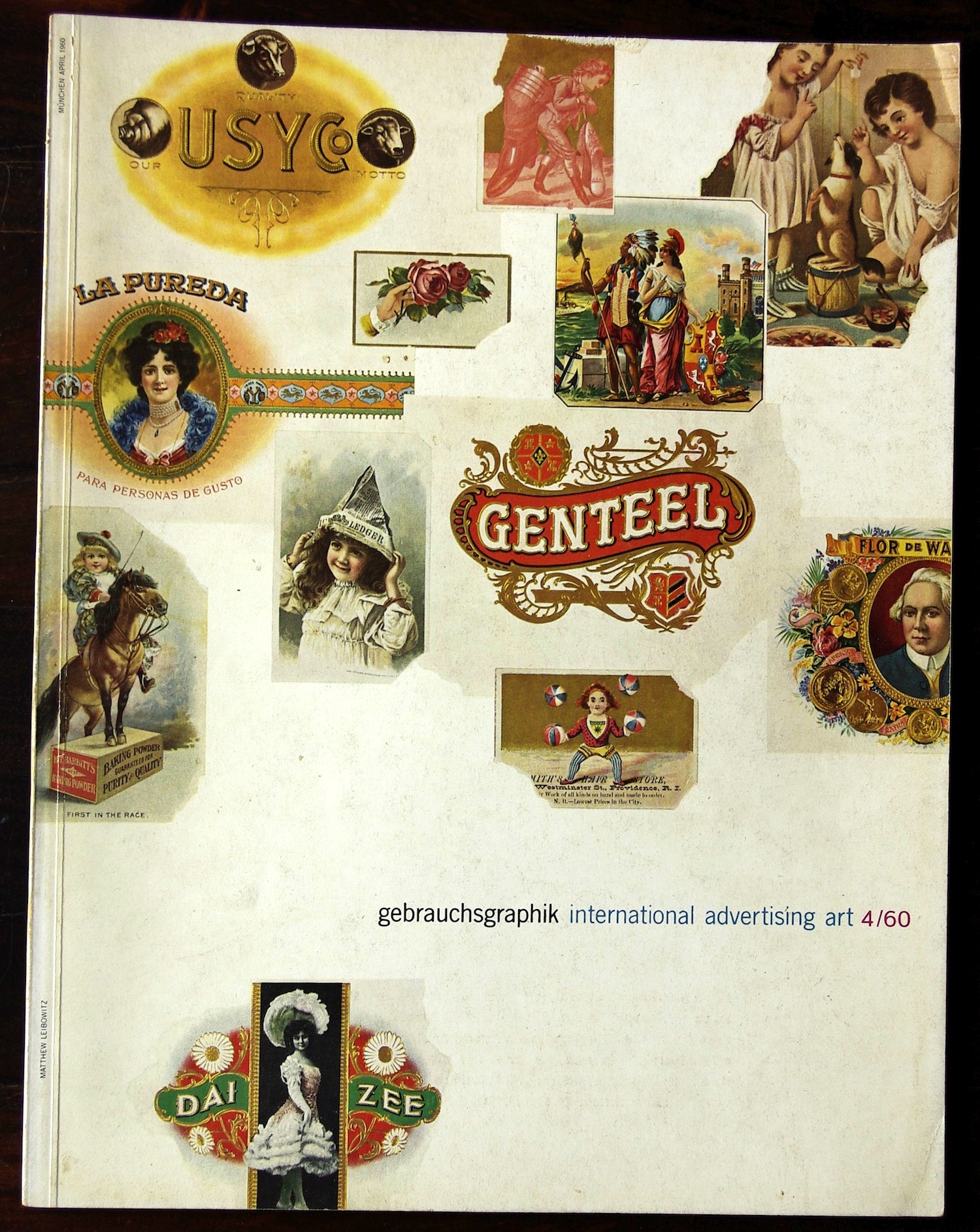Il arrive que certains clients réclament systématiquement une baseline avec leur logo. C’est bien.
Il arrive que certains clients réclament systématiquement une baseline avec leur logo. C’est bien.
Or, l’emploi de ce terme est parfois plus souvent d’ordre psychologique : en effet, le mot est doux à prononcer, il fait aussi son petit effet, surtout en anglais, il montre que vous connaissez un terme de jargon un peu technique. Bref, une baseline sinon rien !
Un échange ubuesque peut alors commencer… : « Une baseline ou un slogan ? » « Oui oui, c’est ça, un slogan quoi. »
On réalise évidemment très vite que le client ne voit peut-être pas forcément la différence dont la subtilité, il est vrai, peut prêter à confusion. Un petit rappel s’impose :
Baseline, le fil rouge informatif
En communication, la baseline (s’écrit aussi base line) informe sur votre entreprise et permet de définir votre activité.
Elle est utilisée en générale pour donner des infos significatives.
Elle n’est pas obligatoire bien sûr, mais elle est plus importante que l’on ne pense car elle permet de mettre en avant votre métier ou votre secteur.
Elle se caractérise par sa position, en général en dessous ou à côté d’un logo, que ce dernier soit représenté par le nom de votre société accompagné d’un symbole ou non.
Dans sa forme, elle n’est pas obligée d’être une phrase ; on peut avoir une succession de mots séparés par une virgule, un point ou un tiret, qui liste vos services par exemple.
Il arrive aussi de voir des sociétés arborant deux ou trois termes qui évoquent ou qualifient l’entreprise, davantage qu’ils ne renseignent sur le métier.
C’est évidemment un choix de positionnement, par exemple pour donner une personnalité ou du mouvement (avec des verbes d’action).
Dans ce cas, une baseline peut se suffire à elle-même et l’entreprise n’aura pas forcément besoin de créer un slogan en plus.
Mais si une vraie phrase est créée, il est préférable qu’elle contienne au moins un mot se référant à la nature de l’activité. Et selon sa forme, cette phrase peut jouer le double rôle de baseline et de slogan ! Dans tous les cas, elle se doit d’être simple.
En publicité, la baseline est également appelée « signature ». Il s’agit en fait de la ligne d’assise : c’est la dernière phrase d’un message qui sert de conclusion à une annonce.
Les marketeurs utilisent souvent le mot « baseline » pour ce procédé, ce qui entretient la confusion, d’autant que l’arrêté du 10 octobre 1985 concernant le vocabulaire de l’audiovisuel et de la publicité, recommande d’employer, ici, le terme « signature« .
Quelle que soit son appellation, une baseline est forcément précédée d’un élément (logo, texte, nom…).
Mais certains parlent également de baseline concernant par exemple les coordonnées et éléments juridiques placés au bas d’une page (suivant la charte graphique déclinée pour la papeterie). Une confusion sur ce terme est donc possible.
Nota
On a gardé le mot en anglais, car en français, « ligne de base » concerne une autre définition, à savoir ce que l’on décrit, en typographie, par la ligne droite, horizontale, et qui délimite la partie inférieure des majuscules et minuscules sur une même ligne de texte. C’est un outil de mesure en quelque sorte.
Or, ici aussi, le terme « baseline » est plus souvent utilisé (même en anglais). Alors que l’on voie bien qu’il existe des différences d’emploi selon certains corps de métiers.
Slogan, le cri de ralliement
À l’inverse de la baseline classique, le slogan est une véritable accroche publicitaire, créé dans l’unique but de capter l’attention à des fins commerciales.
D’ailleurs, l’appellation originelle est « slogan publicitaire ». Elle s’est réduite, probablement pour cause de pléonasme (valable également pour un « slogan politique » qui est aussi fait pour vendre).
Attention, un slogan n’est pas obligatoire – surtout si, comme on l’a vu ci-dessus, la baseline est tournée de manière à remplir les deux rôles.
Donc ce qui est appelée souvent « baseline » tout simplement de par sa position sous le logo, peut en fait consister en un slogan, que les publicitaires appellent également signature (cela permet de différencier les types de slogan).
Il n’est pas non plus obligé de souligner le secteur de votre activité. La stratégie dispose d’une plus grande liberté dans le choix de l’approche du message.
La différence avec une baseline est qu’un slogan peut être utilisé partout dans votre communication, et même à l’oral, dans n’importe quelle situation.
Il est plus libre et mobile qu’une baseline. Le slogan prend toute sa raison d’être pour qualifier un produit.
En tant qu’accroche propre à ce que vous voulez vendre, ce slogan peut se présenter sous la forme d’une phrase, la plus courte possible pour faciliter sa mémorisation.
En effet, même bien trouvée, une phrase longue peut être un piège dans la mesure où elle peut facilement être détournée par le public (si le produit en question s’avère mauvais notamment) ; ce qui deviendrait contre-productif évidemment.
 Pour être efficace, un slogan doit être à la fois compréhensible, fort et original. La simplicité est toujours à privilégier. Mais il doit marquer les esprits, surtout s’il est créé dans le cadre d’une campagne de pub.
Pour être efficace, un slogan doit être à la fois compréhensible, fort et original. La simplicité est toujours à privilégier. Mais il doit marquer les esprits, surtout s’il est créé dans le cadre d’une campagne de pub.
Dans tous les cas, cette phrase n’est pas obligée d’être construite avec un sujet, un verbe, un complément. Toutes les combinaisons sont possibles.
On peut même se passer de verbe : « Priorité au direct » (BFM-TV) ou inversement n’utiliser que des verbes : « Secouez-moi, secouez-moi » (Orangina), « buvez, éliminez » (Vittel).
Je ne peux m’empêcher de citer un célèbre cri de ralliement, très bien trouvé, je veux parler évidemment du « Think different » d’une certaine pomme…
Exemple de différence
Pour mon activité par exemple, j’ai créé un slogan, sans verbe : « La culture du message« . J’ai choisi de l’accoler au logo-titre. (Il fait aussi office de signature, le terme message renvoyant à la notion de communication).
Pour une baseline classique, j’aurais mis plutôt ceci : COMMUNICATION PRINT ET DIGITALE.
Conclusion
Ces petites différences sont importantes. C’est pourquoi il faut bien s’entendre sur la dénomination, au moment de la demande. Cela orientera la stratégie de recherche durant la phase de création.
Juste un slogan ? Juste une baseline ? Les deux, mon Capitaine ? Ou bien une baseline qui fait aussi office de slogan ? Ceci est à déterminer en priorité, par rapport au contexte et aux objectifs.
J’aime à comparer une tasse de thé (une baseline informative, douce) et un morceau de sucre (un slogan qui réveille), sachant qu’un thé sucré est possible. Ça n’a l’air de rien, mais cela évite souvent des quiproquos en cours de route, et bien des désagréments pour le concepteur-rédacteur.
Si vous avez du temps, en lire un peu plus ici.